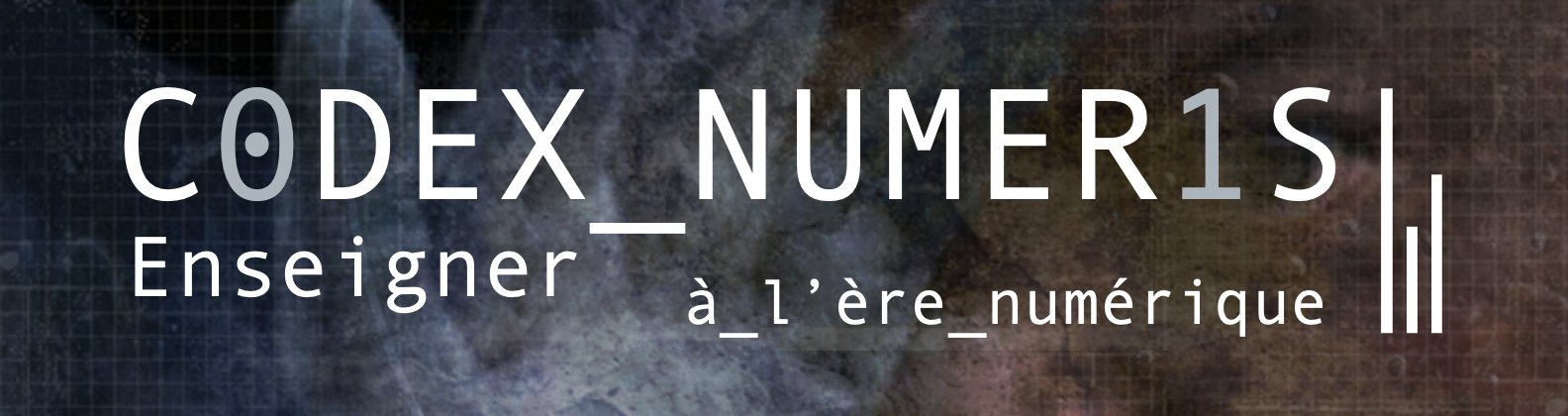37‣ Se préparer à la descente
Comment l'éducation peut-elle préparer aux transitions inévitables d'un monde qui atteint ses limites systémiques ?

L'idée d'effondrement suscite généralement des images apocalyptiques de chaos social et de ruines fumantes. Pourtant, lorsqu'on examine ce concept à travers le prisme des chercheurs qui l'ont étudié, une vision plus nuancée émerge. Dans ce contexte d'incertitude, notre tâche n'est plus tant de transmettre des connaissances techniques que de cultiver la résilience, l'empathie et la créativité nécessaires pour s'adapter aux défis sans précédent qui nous attendent.

La nature de l'effondrement
► POUR qu'une société s'effondre, elle doit avoir atteint un certain degré de complexité pendant au moins quelques générations, puis connaître une réduction substantielle de cette complexité en quelques décennies. Joseph Tainter définit l'effondrement comme «une perte rapide et déterminante d'un niveau établi de complexité socio-politique.» (Tainter, p. 4) Jared Diamond complète cette définition en parlant d'une «réduction drastique de la population humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue et une durée importante.» (Diamond, p. 15)
L'effondrement n'est donc pas un événement ponctuel, mais un processus, une transition vers un niveau de complexité moindre. Comme le souligne Dimitry Orlov, «quand les sociétés défaillent, leur culture ne se volatilise pas, du moins pas immédiatement. Elles finissent plutôt dans la fameuse poubelle de l'histoire. Cette poubelle, à défaut d'autre chose, devra être pour nous le coffre au trésor des idées à redécouvrir et ressusciter.» (Orlov, p. 340)
Ce qui distingue notre époque des effondrements précédents, c'est la dimension globale du phénomène. Diamond observe que «les sociétés sont à ce point interconnectées que le risque auquel nous sommes confrontés est celui d'un déclin mondial.» (Diamond, 576) Cette interconnexion crée une vulnérabilité systémique sans précédent dans l'histoire humaine.
Les causes systémiques de l'effondrement
La complexité croissante de nos sociétés requiert un flux d'énergie toujours plus important pour se maintenir. Tainter a démontré que «à un certain point dans l'évolution d'une société, l'investissement constant dans la complexité en tant que stratégie de résolution des problèmes produit un rendement marginal décroissant.» (Tainter, p. 140) En d'autres termes, les solutions d'hier deviennent les problèmes d'aujourd'hui, et résoudre ces nouveaux problèmes exige toujours plus d'énergie et de ressources.
L'équipe de Donella Meadows, dans le rapport «Limits to Growth», a démontré l'impossibilité mathématique d'une croissance exponentielle dans un monde aux ressources finies. Ce qui était une prédiction en 1972 est devenu aujourd'hui une réalité mesurable : «l'humanité avait déjà dépassé les limites de la capacité de charge de la planète.» Ce dépassement (overshoot) conduit inévitablement soit à un effondrement involontaire, soit à une réduction contrôlée de notre empreinte écologique.
Notre dépendance aux combustibles fossiles représente une vulnérabilité particulière. Nous connaissons une croissance exponentielle depuis 200 ans grâce à l'énergie fossile facilement accessible. Cette croissance a permis de passer de 2,5 milliards d'individus en 1950 à plus de 7,6 milliards aujourd'hui, créant une population totalement dépendante du commerce et du transport alimentaires pour survivre.
À ces facteurs s'ajoute ce que Bonneuil et Fressoz nomment «l'événement Anthropocène» – cette révolution géologique d'origine humaine où notre impact sur la planète atteint une échelle géologique. «Dans l'histoire géologique, tout comme dans leurs modélisations du futur, les scientifiques ont détecté des points de basculement du climat et des seuils d'effondrement brutal des écosystèmes.» (Bonneuil, p. 36) Ces points de non-retour représentent des limites que notre civilisation a peut-être déjà franchies.
Les manifestations de l'effondrement en cours
L'effondrement ne se manifeste pas nécessairement par un événement spectaculaire, mais par une succession de crises qui érodent progressivement la résilience du système. Comme l’affirme Yves Cochet, l'effondrement est «un processus à l'issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi.»
Cette définition nous permet de reconnaître plusieurs signaux d'effondrement déjà présents.
- La précarisation énergétique, avec l'ère du pétrole facile qui s'achève et un taux de retour énergétique en déclin pour les ressources restantes.
- La déstabilisation climatique, avec des événements extrêmes de plus en plus fréquents et intenses.
- L'érosion de la biodiversité, que Wallace-Wells qualifie de «sixième extinction de masse».
- La fragilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, révélée notamment par la pandémie.
- L'augmentation des inégalités sociales et la montée des tensions géopolitiques.
Ces manifestations ne sont pas des phénomènes isolés, mais des symptômes interconnectés d'un système qui atteint ses limites. La réalité du monde contemporain est devenue si complexe qu'aucun esprit humain ne peut la saisir complètement.
Les paradigmes alternatifs émergeants
Face à cette perspective, plusieurs paradigmes alternatifs émergent. La décroissance, loin d'être un projet d'austérité imposée, représente «une prise de conscience qui se traduit par un refus. Refuser de me faire séduire par la publicité et de consommer (compulsivement) à crédit, réduire ma consommation, réutiliser ce que j'ai, réparer ce qui peut l'être, recycler ce qui ne le peut pas.»
La transition, quant à elle, permet «d'adapter progressivement à la descente énergétique» nos modes de vie. Cette adaptation passe par la sobriété énergétique, la relocalisation des activités et la reconstruction de communautés résilientes. Comme je l'ai écrit, «le Réseau de la transition [...] est un réseau très actif, étendu dans plus de 50 pays, constitué de milliers de gens qui sont conscients des défis qui se dressent devant eux. Ils ont décidé d'agir maintenant, dans leur localité, non pas pour changer le monde (car il est trop tard), mais pour se changer eux-mêmes.»
Le rôle de la transmission face à l'effondrement
Dans ce contexte, la question de la transmission des connaissances devient cruciale. Roy Scranton, dans «Learning to die in the Anthropocene : reflections on the end of a civilization», suggère que «la seule chose qui puisse faire du sens et puisse peut-être sauver l'humanité, c'est la mémoire.» (Scranton, 2019) Notre mémoire collective, l'histoire de la sagesse millénaire et l'héritage culturel que nous laissent les générations précédentes constituent «notre plus précieux cadeau pour l'avenir.» (Scranton, 2019)
Cette perspective rejoint celle de Diamond lorsqu'il observe que «le passé est pour nous une riche banque de données dans laquelle nous pouvons puiser pour nous instruire, si nous voulons continuer à aller de l'avant.» (Diamond, 2006, p. 15) Les sociétés qui s'effondrent ne sont pas nécessairement celles qui font face aux défis les plus importants, mais celles qui n'arrivent pas à adapter leurs institutions et leurs valeurs à des conditions changeantes. Par contre, Harari ajoute que «L'étrangeté devenant la nouvelle norme, vos expériences passées, comme celle de toute l'humanité, deviendront des guides moins fiables. Les individus et l'humanité dans son ensemble devront de plus en plus affronter des choses que personne d'autre n'aura encore jamais rencontrées.» (Harari, 2018, p. 285)
L'éducation, dans ce contexte, ne peut plus se contenter de transmettre des connaissances techniques ou de préparer à des carrières qui risquent de ne plus exister dans un monde post-croissance. «Pour être à la hauteur du monde de 2050, il faudra non seulement inventer des idées et des produits, mais d'abord et avant tout se réinventer sans cesse.» (Harari, 2018, p 282) L'éducation doit donc développer «la capacité d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles et de préserver notre équilibre mental dans des situations peu familières.» Harari ajoute que «Pour survivre et s'épanouir dans un monde pareil, il faut beaucoup de souplesse mentale et de grandes réserves d'équilibre émotionnel. Vous devez vous défaire régulièrement d'une partie de ce que vous connaissez le mieux pour vous sentir à l'aise dans l'inconnu.» (Harari, 2018, p. 285)
Cette vision de l'éducation comme développement de la résilience plutôt que comme simple transmission de connaissances techniques s'inscrit parfaitement dans le cadre de la permaculture pédagogique. Elle valorise la diversité cognitive, cultive l'autonomie d'apprentissage et renforce les capacités d'adaptation face à l'incertitude.
Vers une renaissance
L'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle n'est pas tant une fin en soi qu'une transition vers un paradigme différent. Comme l'écrit Carolyn Baker, «la joie est la sensation profonde de raison d'être et de sens que nous ressentons en nous préparant» à la décroissance et à l'effondrement (Baker, p. 59-60). Cette perspective peut sembler paradoxale, mais elle reflète une vérité profonde : l'effondrement de structures devenues insoutenables ouvre la voie à de nouvelles formes d'organisation sociale potentiellement plus épanouissantes.
Cette transition n'est pas un processus facile. Elle implique un deuil – celui d'un monde en train de disparaître – mais aussi une naissance, celle d'un nouveau rapport au monde.
Dans ce contexte d'incertitude radicale, notre tâche n'est pas tant de prévoir avec exactitude l'avenir que de cultiver les qualités qui nous permettront de nous adapter à ses multiples possibilités : résilience, empathie, créativité, coopération. Ces qualités représentent peut-être notre meilleur espoir face aux défis sans précédent qui nous attendent.
En comprenant la nature systémique de l'effondrement en cours, nous pouvons dépasser la paralysie de la peur et commencer à construire, ici et maintenant, les fondations d'un monde post-croissance plus juste et plus durable.
La vision des transitions futures selon Holmgren
David Holmgren aborde la notion de transition non-linéaire dans «Future Scenarios», bien que sa conceptualisation soit plus spécifique et structurée autour de différents scénarios énergétiques et climatiques possibles.
Dans cet ouvrage, Holmgren développe quatre scénarios de futurs possibles basés sur l'interaction de deux variables principales: la vitesse du déclin énergétique (graduel ou brutal) et l'intensité du changement climatique (modéré ou sévère). Chacun de ces scénarios représente une voie de transition distincte pour nos sociétés:
- Techno-stabilité (déclin énergétique graduel, changement climatique modéré) - Une adaptation progressive où la technologie permet de maintenir certains aspects de la complexité sociétale actuelle.
- Techno-explosion (disponibilité énergétique maintenue, changement climatique sévère) - Une tentative de résoudre les problèmes climatiques par des solutions technologiques à grande échelle.
- Gestion de la terre («Earth Stewardship») (déclin énergétique rapide, changement climatique modéré) - Une relocalisation forcée et une simplification des systèmes socio-économiques.
- Effondrement de la vie («Lifeboats») (déclin énergétique rapide, changement climatique sévère) - Un effondrement sociétal profond où seules subsistent des poches de résilience.
La vision de Holmgren est explicitement non-linéaire, car elle reconnaît plusieurs points essentiels.
- Différentes vitesses de transition selon les régions - Holmgren note que ces scénarios ne se développeront pas uniformément à l'échelle mondiale. Certaines régions pourront expérimenter un scénario «techno-stabilité» tandis que d'autres seront déjà en mode «gestion de la terre» ou même «lifeboats».
- Séquentialité possible des scénarios - Il suggère que ces scénarios peuvent représenter des phases successives plutôt que des alternatives mutuellement exclusives. Une société pourrait traverser plusieurs de ces états au fil du temps.
- Coexistence de multiples réalités - Dans un même territoire, différentes communautés pourraient vivre selon des modes d'organisation distincts, certaines maintenant une complexité élevée, d'autres adoptant des approches plus résilientes et localisées.
Holmgren écrit spécifiquement: « J'imagine que la permaculture (par ses principes et son modèle, sinon par son nom) deviendra le paradigme dominant dans le scénario d'intendance de la Terre. Ceux qui ont une longue expérience d'accomplissements deviendront les leaders naturels au sein des nouvelles structures de pouvoir émergentes, principalement au niveau local, qui seront plus efficaces que les niveaux supérieurs de gouvernance et d'organisation. » (Holmgren, 2014, p. 110)
En ce sens, la démarche pédagogique permaculturelle représente une préfiguration du scénario «Earth Stewardship» appliqué à l'éducation – une approche adaptée à un monde de descente énergétique où les solutions locales, résilientes et à faible empreinte prennent progressivement le pas sur les systèmes centralisés et énergivores.
La vision de Holmgren nous invite ainsi à considérer que la transition n'est pas simplement une alternative théorique, mais potentiellement une nécessité adaptative face aux contraintes énergétiques et écologiques qui façonneront inévitablement notre avenir collectif.
Une transition inévitable mais non linéaire
Le paradigme industriel montre clairement des signes de tension systémique qui annoncent sa transformation profonde, sinon son effondrement. Le paradigme permaculturel, avec son accent sur la diversité, les cycles et l'autonomisation, représente une alternative théoriquement viable et particulièrement adaptée à un monde confronté à des contraintes écologiques croissantes.
Cependant, la transition entre ces paradigmes ne sera probablement ni rapide ni complète. Elle impliquera vraisemblablement des phases d'hybridation, d'adaptation et de transformation progressive, ponctuées par des moments d'accélération lors de crises systémiques.
Souhaitons que l’éducation représente ce que Donella Meadows appelait un «point de levier» – des interventions locales qui, par leur exemple et leurs résultats, peuvent influencer des transformations plus larges du système. En ce sens, elle participe déjà à cette transition qui, bien qu'incertaine dans ses modalités précises, semble de plus en plus inévitable dans son principe. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Ce
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 7 avril 2025 · Révisé le 8 juillet 2025
Références
Baker, C. (2015). L'effondrement : Petit guide de résilience en temps de crise. Écosociété.
Bédard, G. (2018a). De nouveaux paradigmes (1/3) : Décroissance. Panorama21.
Bédard, G. (2018b). De nouveaux paradigmes (2/3) : Transition. Panorama21.
Bédard, G. (2018c). De nouveaux paradigmes (3/3) : L'incertitude. Panorama21.
Bédard, G. (2019). Enseigner dans l'Anthropocène. Panorama21.
Bihouix, P. (2014). L'âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable. Seuil.
Brown, L. R. (2012). Basculement : Comment éviter l'effondrement économique et environnemental. Rue de l'Échiquier.
Cochet, Y. (2011, 27 mai). L'effondrement, catabolique ou catastrophique ? [Communication]. Institut Momentum. http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/11/L'effondrement-catabolique-ou-catastrophique.pdf
Cochet, Y. (2017, 23 août). De la fin d'un monde à la renaissance en 2050. Libération. http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-2050_1591503
Diamond, J. (2006). Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Gallimard. (Ouvrage original publié en 2005)
Harari, Y. N. (2017). Homo deus : Une brève histoire du futur. Albin Michel. (Ouvrage original publié en 2015)
Harari, Y. N. (2018). 21 leçons pour le XXIe siècle. Albin Michel. (Ouvrage original publié en 2018)
Heinberg, R. (2014a). Pétrole la fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier. Demi-Lune. (Ouvrage original publié en 2003)
Heinberg, R. (2014b). La Fin de la croissance : S'adapter à notre nouvelle réalité économique. Demi-Lune. (Ouvrage original publié en 2011)
Holmgren, D. (2014). Permaculture : Principes et voies d'application pour une terre nourricière. Rue de l'Échiquier. (Ouvrage original publié en 2002)
Holmgren, D. (2021). Futures Scenarios : How Communities Can Adapt to Peak Oil and Climate Change. Chelsea Green Publishing. (Ouvrage original publié en 2009)
Hopkins, R. (2010). Manuel de transition : De la dépendance au pétrole à la résilience locale. Écosociété. (Ouvrage original publié en 2008)
Mead, H. (2017). Trop tard : La fin d'un monde et le début d'un nouveau. Écosociété.
Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2012). Les Limites à la croissance (dans un monde fini). Rue de l'Échiquier. (Ouvrage original publié en 1972)
Meadows, D. H. (2023). Pour une pensée systémique. Rue de l'Échiquier. (Ouvrage original publié en 2008)
Orlov, D. (2016). Les cinq stades de l'effondrement : Guide du survivant. Le Retour aux Sources. (Ouvrage original publié en 2013)
Rubin, J. (2010). Demain un tout petit monde : Comment le pétrole entraînera la fin de la mondialisation. Hurtubise. (Ouvrage original publié en 2009)
Rubin, J. (2012). La fin de la croissance. Hurtubise. (Ouvrage original publié en 2012)
Scranton, R. (2015). Learning to Die in the Anthropocene: Reflections on the End of a Civilization. City Lights Books.
Scranton, R. (2019). We're Doomed. Now What?: Essays on War and Climate Change. Soho Press.
Servigne, P., & Stevens, R. (2015). Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Seuil.
Servigne, P., Stevens, R., & Chapelle, G. (2018). Une autre fin du monde est possible : Vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre). Seuil.
Tainter, J. A. (2020). L'effondrement des sociétés complexes. Le Retour aux Sources. (Ouvrage original publié en 1988)
Wallace-Wells, D. (2020). La Terre inhabitable : Vivre avec 4 degrés de plus. Robert Laffont. (Ouvrage original publié en 2019)
À explorer
Pour appliquer la permaculture aux organisations éducatives :
- 41‣ Penser l'écologie de nos organisations - Traduire concrètement les concepts de Tainter sur l'effondrement des systèmes complexes en proposant une alternative permaculturelle aux modèles hiérarchiques épuisés, offrant un cadre pratique pour la «gestion de la terre» appliquée à l'éducation
Pour développer la résilience face à l'incertitude :
- 8‣ Développer une pensée vigilante - Explorer le changement paradigmatique nécessaire pour préparer les élèves au monde de 2050 selon Harari, passant de la transmission traditionnelle au développement de capacités d'adaptation et de réinvention permanente
Pour résister aux disruptions tout en s'adaptant :
- 32‣ Tenir le coup face à la disruption - Analyser les stratégies de résistance face aux transformations accélérées et montre comment l'école peut demeurer un espace de pensée authentique contre l'automatisation cognitive
Pour une approche systémique de l'adaptation :
- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - Appliquer la pensée systémique à l'éducation, démontrant comment cultiver la résilience et l'intelligence collective dans nos «écosystèmes-classes» face aux perturbations externes