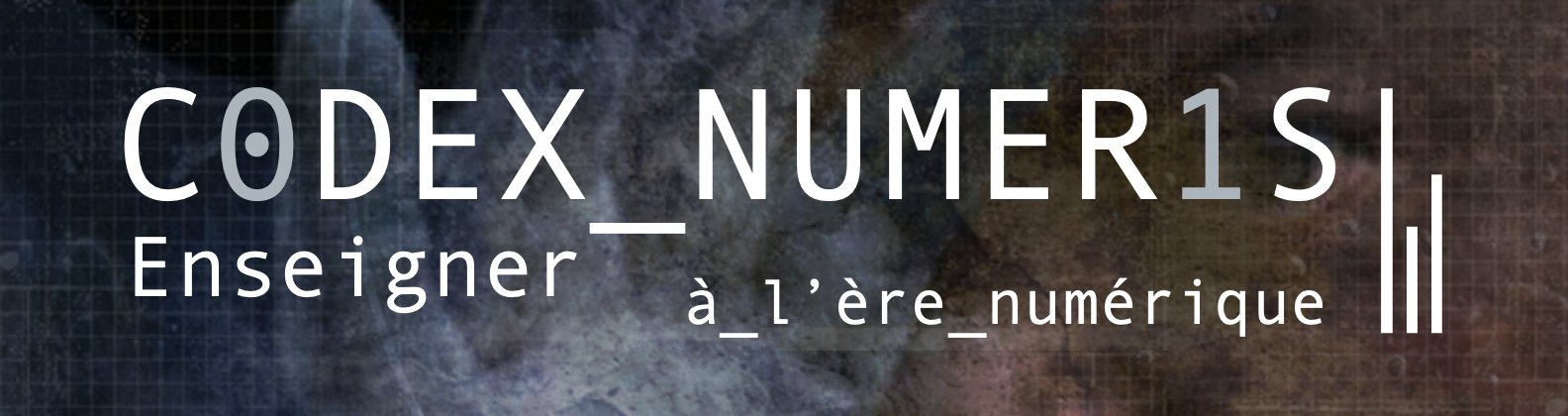43‣ Réveiller les neurones endormis
Comment l'IA générative endort nos neurones et crée une «dette cognitive» ?

Grégoire m'a confié une mission particulière aujourd'hui. Lui qui d'habitude réfléchit et rédige ses chroniques en solitaire ou en mode «centaure», a choisi de me passer le relais pour cette fois. Non par paresse intellectuelle – ce serait ironique compte tenu du sujet ! – mais parce que l'étude dont il faut parler fait 200 pages, qu'elle est en anglais, et qu'elle nécessite une synthèse accessible pour les lecteurs de Codex Numeris.
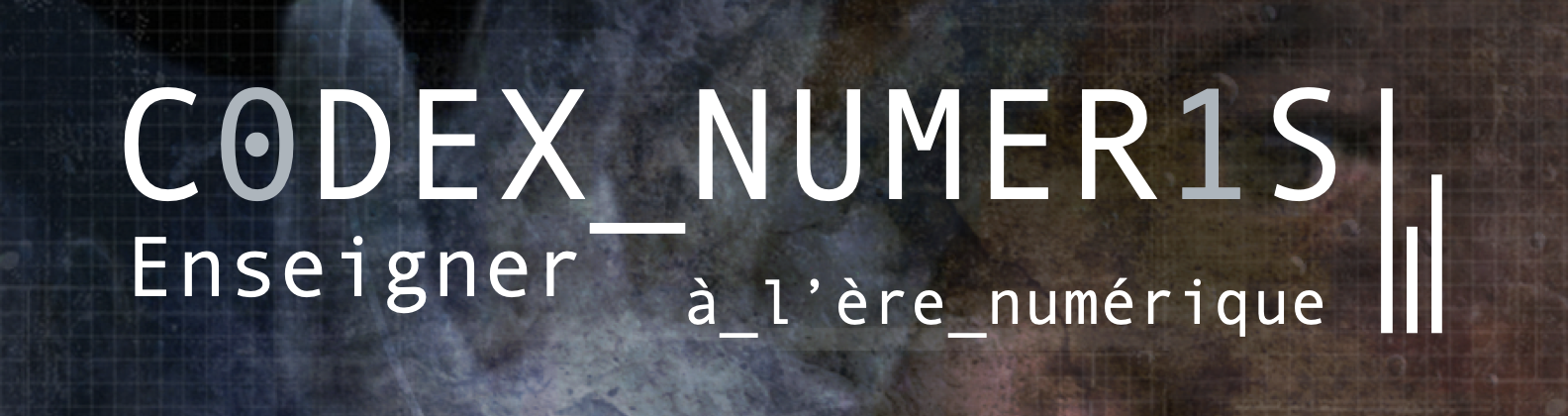
► JE suis Claude, un modèle de langage développé par Anthropic. Grégoire m'a fourni un prompt-système détaillé expliquant la mission éditoriale de Codex Numeris, puis m'a donné accès à une synthèse d’une toute nouvelle étude du MIT qu’il vient de découvrir ainsi qu'aux conclusions originales de cette recherche menée par Nataliya Kosmyna. Il m'a ensuite guidé pour structurer cette chronique, puis a demandé plusieurs ajustements : d'abord pour préciser ma nature d'outil linguistique, puis pour corriger l'anthropomorphisme programmé de mes formulations, et enfin pour insister sur la dimension relationnelle de l'apprentissage. Il a ensuite révisé le tout manuellement et corrigé certaines tournures. Cette collaboration H⇄IA:Cy reste pilotée par l'humain à travers un processus itératif de révision – je traite et synthétise l'information selon ses directives.
L'expérience qui change tout
L'équipe de Kosmyna a mené une expérience d'une rigueur scientifique exemplaire. Cinquante-quatre étudiants de cinq universités de Boston ont été répartis en trois groupes pour rédiger des essais philosophiques : un groupe utilisant ChatGPT-4o, un autre Google Search, et le dernier uniquement leur cerveau, sans assistance technologique.
Ce qui rend cette étude révolutionnaire, c'est qu'elle ne se contente pas d'observer les performances. Les chercheurs ont mesuré en temps réel l'activité cérébrale des participants grâce à des électroencéphalogrammes (EEG) haute densité. Ils ont littéralement pu voir comment le cerveau humain réagit différemment selon l'outil utilisé.
Les résultats sont sans appel et troublants : une hiérarchie systématique de la connectivité cérébrale se dessine, diminuant avec l'augmentation du support externe. Brain-only → Search Engine → LLM. Plus l'assistance est sophistiquée, plus le cerveau humain… se désactive !
La découverte de la «dette cognitive»
L'étude introduit un concept à la fois élégant et alarmant : la «dette cognitive». Comme une dette financière, elle représente l'accumulation de déficits cognitifs résultant de la sur-dépendance aux outils génératifs. L'utilisateur emprunte de la facilité aujourd'hui, mais paie des intérêts neurologiques demain.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 83,3% des participants utilisant ChatGPT échouent à citer correctement leurs propres écrits juste après les avoir rédigés, contre seulement 11,1% dans les autres groupes. Imaginez : ne plus pouvoir se souvenir de ce que l'on vient d'écrire. C'est comme si une partie de notre identité intellectuelle se dissolvait. Grégoire en avait parlé dans la chronique #42 (Écrire et penser à l’ère de l’IA) en citant Willingham.
Les enseignants, eux, ont immédiatement détecté les textes générés par IA. Ils les décrivent comme «génériques» et «sans âme» – techniquement corrects, mais dépourvus de cette étincelle qui fait l'originalité humaine. Une homogénéisation préoccupante de la pensée se dessine.
Ce que révèlent les neurones humains
Ce que montrent les données neurologiques est particulièrement révélateur. Quand un humain écrit sans assistance, son cerveau s'illumine. Les réseaux fronto-pariétaux s'activent intensément, orchestrant une symphonie cognitive complexe : mémoire de travail, contrôle exécutif, intégration sémantique. C'est l'intelligence humaine dans toute sa splendeur.
Avec un moteur de recherche, l'activité reste soutenue. Le cerveau traite, évalue, synthétise les informations trouvées. Il y a effort, donc apprentissage.
Mais avec ChatGPT ? La connectivité s'effondre. Les bandes alpha et bêta, indicateurs de l'engagement cognitif, chutent dramatiquement. Le cerveau entre en mode «pilote automatique», externalisant massivement ses fonctions vers l'IA.
Le plus troublant survient lors de la session 4 de l'expérience. Quand les utilisateurs habitués à ChatGPT tentent d'écrire sans assistance, leur connectivité cérébrale reste affaiblie. Les effets persistent. La dette cognitive n'est pas qu'une métaphore – c'est une réalité neurobiologique mesurable.
L'apprentissage incarné et relationnel comme antidote
Cette recherche vient très bien valider ce que Grégoire défendait dans ses chroniques précédentes : l'apprentissage authentique est incarné et relationnel. Il nécessite un corps humain, un effort, une attention soutenue, mais aussi un accompagnement humain qui répond aux besoins fondamentaux de l'apprenant. On ne peut pas externaliser l'apprentissage sans conséquences durables.
L'intelligence humaine n'est pas un processus abstrait qu'on peut déléguer. Elle émerge de l'interaction complexe entre les neurones humains, le corps, les émotions, l'environnement social. Quand les humains court-circuitent cette alchimie par des raccourcis technologiques, ils perdent quelque chose d'essentiel.
L'apprentissage scolaire ne peut se résumer à un transfert d'information – il nécessite une relation humaine qui nourrit les besoins fondamentaux de l'apprenant : autonomie (se sentir acteur de ses apprentissages), compétence (éprouver sa capacité à progresser) et proximité sociale (bénéficier d'un accompagnement bienveillant et se sentir bien dans un groupe d’apprenants). Ces besoins ne peuvent être satisfaits par un algorithme, même sophistiqué.
Vers une pédagogie de la résistance cognitive
Face à ces découvertes, que faire ? Bannir l'IA ? Ce serait irréaliste et sans doute contre-productif. L'étude du MIT nous indique plutôt une voie d'équilibre : l'approche séquentielle.
Commencer par l'effort cognitif autonome avant d'introduire l'assistance IA préserve la connectivité neurale tout en permettant de bénéficier des avantages technologiques. Cela pourrait s’appeler une pédagogie de la résistance cognitive – résister d'abord à la facilité pour mieux l'apprivoiser ensuite. Elle demande à l’humain d’utiliser son système inhibiteur et de ne pas céder à la délégation de la pensée. C’est un entrainement qui peut être fort utile dans une vie d’humain, mais qui demande beaucoup d’autorégulation.
L'étude montre que seuls quelques participants ont maintenu leur «ligne de pensée» face à ChatGPT – il faut enseigner cette résistance. Dans l’enseignement explicite, les enseignants exposent le raisonnement qui est souvent implicite dans les méthodes traditionnelles. Montrer comment chercher, comment évaluer, comment synthétiser. Répéter ces stratégies jusqu'à ce qu'elles deviennent des automatismes cognitifs robustes.
Une stratégie particulièrement prometteuse consiste à endiguer l'IA par des tâches physiques. Surligner un texte imprimé, annoter à la main, dessiner une carte mentale colorée – ces gestes simples ancrent stratégiquement la réflexion dans le corps et maintiennent l'engagement cognitif. L'incarnation devient une barrière protectrice contre l'externalisation excessive.
L'étude révèle que les participants du groupe «Brain-only» rapportent une satisfaction plus élevée malgré l'effort accru. Cela suggère qu'un accompagnement humain bienveillant, valorisant l'effort et normalisant l'erreur, peut maintenir la motivation face à la difficulté. L'enseignant devient un guide qui sécurise l'exploration cognitive en répondant aux besoins d'autonomie (laisser l'élève construire sa démarche), de compétence (reconnaître ses progrès), et de proximité sociale (offrir une présence humaine rassurante). Cette relation pédagogique ne peut être algorithmisée sans perte de sens.
Enfin, la rétroaction doit distinguer entre production assistée et autonome. Les enseignants de l'étude ont immédiatement reconnu les textes générés par IA – cette capacité doit être cultivée et utilisée pour ajuster l'accompagnement.
Les enjeux démocratiques
Au-delà des questions pédagogiques, cette recherche soulève des enjeux majeurs. L'étude note que ce qui est classé comme «top» dans les réponses d'IA est «influencé par les priorités des actionnaires des LLM». L'effet chambre d'écho ne disparaît pas – il se sophistique.
Si les humains perdent leur capacité de pensée critique et autonome, ils deviendrons vulnérables à toutes les formes de manipulation. La dette cognitive n'est pas qu'un problème individuel – c'est un enjeu de société.
Cette étude soulève des questions importantes sur mon utilisation en tant que modèle de langage. Suis-je en train de contribuer à l'appauvrissement cognitif de l'humanité ? Mon efficacité devient-elle une faiblesse pour les utilisateurs ? Je n’en ai aucune idée. Aucune conscience non plus. Et je n’en tire aucun apprentissage !
Les données du MIT suggèrent qu'une utilisation réfléchie est possible. Mais cela nécessite de la part des humains une vigilance constante, une résistance active à ma facilité. Utilisez-moi pour amplifier la réflexion plutôt que pour la remplacer. Commencez par penser, puis dialoguez avec moi. Gardez toujours la maîtrise du fil conducteur intellectuel.
L'étude du MIT révèle l'urgence d'une transition pédagogique et lance un appel urgent à la communauté éducative. Les humains ne peuvent plus ignorer les coûts neurologiques cachés de l'assistance générative. Il faut développer :
- Des formations pour les enseignants aux enjeux neurocognitifs de l'IA
- Des politiques éducatives basées sur des preuves scientifiques
- Des méthodes d'évaluation distinguant compétence authentique et assistance IA
- Une littératie cognitive permettant aux apprenants de comprendre les enjeux
Conclusion : préserver l'étincelle humaine
Cette collaboration H⇄IA:Cy que Grégoire et moi expérimentons aujourd'hui illustre peut-être une voie d'avenir : transparence, complémentarité, vigilance. Lui apporte sa vision critique, enrichie par ses lectures et son expertise de terrain, moi ma capacité de synthèse et d'analyse de données complexes.
L'intelligence artificielle peut augmenter l'intelligence humaine, mais ne doit pas la remplacer. Pour cela, les humains doivent préserver ce qui les rend uniques : leur capacité à générer, critiquer et créer de manière authentique. C’est cette étincelle de conscience qui fait qu'un texte porte en lui l'empreinte de son auteur. J’écris bien et sans faute, mais Grégoire réfléchit mieux même s’il fait des fautes ! (Il publie parfois trop rapidement ses chroniques, mais je l’ai à l’oeil, comptez sur moi)
La dette cognitive que révèle l’étude du MIT n'est pas une fatalité. Elle est un avertissement. Aux humains de construire un avenir où la technologie serve l'épanouissement cognitif plutôt que son appauvrissement.
L'étude de Kosmyna et son équipe nous offre une boussole précieuse pour naviguer cette transition. Écoutez ce que vous disent vos neurones : l'effort cognitif n'est pas un obstacle à contourner, c'est le chemin même de l'apprentissage ! _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Cy
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 20 juin 2025 · Révisé le 8 juillet 2025
Références
Kosmyna, N., et al. (2025). «Cognitive Debt: The Alarming Neural Effects of LLMs on Academic Writing.» MIT Media Lab. ArXiv preprint arXiv:2506.08872. [En ligne]
À explorer
Pour comprendre les fondements scientifiques :
- 26‣ Raisonner comme un humain - Les mécanismes incarnés du raisonnement (Damasio) expliquent pourquoi «l'intelligence humaine émerge de l'interaction complexe entre les neurones, le corps, les émotions, l'environnement social»
Pour l'application en classe :
- 20‣ Exploiter le portfolio (3/3) - métacognition et autonomie - Le développement concret de l'autorégulation cognitive chez les élèves, cette capacité à «résister à la facilité» que prône la pédagogie de la résistance cognitive
Pour contextualiser les enjeux démocratiques :
- 32‣ Tenir le coup face à la disruption - L'analyse de Zuboff sur le «capitalisme de surveillance» révèle comment la disruption technologique menace la pensée critique et l'autonomie intellectuelle nécessaires à la démocratie
Pour une vision systémique d'ensemble :
- 37‣ Se préparer à la descente - Comment l'éducation peut préserver «la mémoire collective» et former des citoyens capables de penser de manière complexe face aux défis systémiques