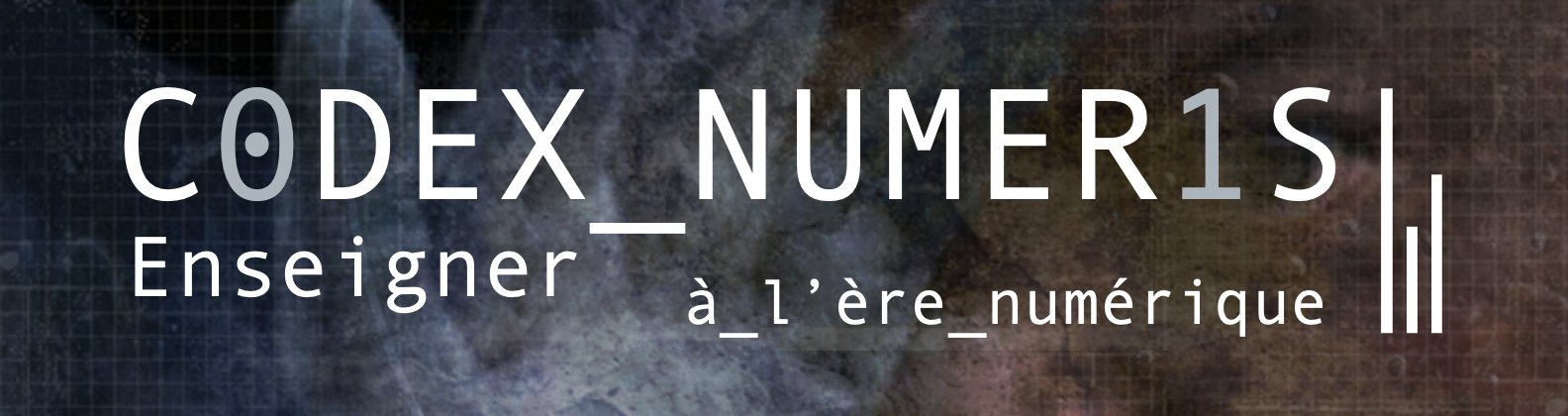P21‣ Après demain (quelques notes)
Notre société et notre communauté collégiale après la transition


La communauté enseignante : mythe ou réalité ?
► LA «communauté enseignante» n’existe pas en tant que tissu social. Les liens sont trop faibles pour dire qu’il s’agit d’un groupe animé par des valeurs communes et une vision relativement cohérente des choses.
Par contre, dire que nous n’avons en commun qu’un statut de salariés du cégep est un peu réducteur à mon avis.
La «communauté enseignante» est davantage un potentiel, quelque chose en devenir : un réseau de communs.
La communauté comme commun
Un commun est constitué par un groupe de personnes qui organise collectivement l’usage d’une ressource qui lui est propre.
Pour ma part, je pense que le cégep (comme infrastructure publique) et le corps enseignant (qui produit de l’information, de l’éducation comme telle, avec ses multiples cerveaux) sont la ressource dont nous disposons. Il est tout à fait légitime que nous en établissions des règles d’usage, puisque nous sommes partie prenante de cette ressource. Dans l’écosystème collégial, il faut aussi tenir compte des professionnels, des employés de soutien et des élèves (qui sont de passage sur le «territoire»). Pour ma part, pendant mon passage au syndicat, j’ai essayé de plusieurs façons de favoriser cette reconnaissance de l’autonomie : déclaration pour un cégep du 21e siècle, Panorama21, wiki sur la bibliothèque, divers comités sur Framavox, etc. Les expérimentations n’ont malheureusement pas été très durables.
Ma ressource, c’est mon corps et mon cerveau, c’est ma personne, mes connaissances, ma rationalité, mes compétences émotionnelles, mon imagination, ma sensibilité. Tout cela me permet de créer, de transformer de l’information avec l’énergie de mon corps. Ensemble, nous avons une intelligence collective où circule un flux d’informations. Ce flux est une ressource avec laquelle nous travaillons, mais qui n’est pas beaucoup exploitée aujourd’hui. Par une combinaison symbiotique des différentes communautés, par une mise en réseau des différents communs, nous pouvons concevoir un écosystème très efficient et très résilient. Imagine un instant la qualité de l’éducation citoyenne qui peut naître d’un tel écosystème...
Je vois différents communs au cégep : le comité de réflexion éthique en enseignement, la publication Panorama21 bien sûr, mais aussi le groupe qui s’est rencontré le 4 juin lors de la journée thématique sur le bien-être. Dans ces cas, les «usagers» ont besoin de définir les règles d’usage de quelque chose qui leur est commun : un magazine, des relations ou le bien-être.
Autonomie et commun
Pour réaliser ces différents communs, il est important de favoriser l’autonomie professionnelle le plus possible. Le syndicat a un rôle majeur à jouer sur ce plan, mais je pense que l’exécutif syndical ne comprend pas très bien cette importance (elle ne se réduit pas à la gestion des congés de maladie et au report de disponibilité). L’autonomie, c’est la possibilité de prendre des décisions en tant que professionnel reconnu par ses pairs et par les gestionnaires. C’est très politique. L'autonomisation, c'est de l'«empowerment», et les gens qui préfèrent la hiérarchie et le contrôle ont bien de la difficulté avec ça...
Se servir du mythe pour changer la réalité
Que la «communauté enseignante» n’existe pas tout à fait n’est pas contradictoire avec le fait d’en parler comme d’une chose réelle. La fiction peut très bien être un catalyseur de la réalité… Ça a toujours été mon souhait avec cette publication en tout cas. Que le mot existe dans l’esprit des gens peut déjà faire advenir la réalité dans la vraie vie. S’il n’est pas là, c’est chose impossible en tout cas. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Inédit originellement prévu dans Panorama21 en 2019 · Publié le 5 mai 2025 dans Codex Numeris · Révisé le 8 juillet 2025
Références
Delannoy, I. (2017). L'économie symbiotique : Régénérer la planète, l'économie et la société. Actes Sud.
Dion, C. (2018). Petit manuel de résistance contemporaine : Récits et stratégies pour transformer le monde. Actes Sud.
Fisher, M. (2018). Le Réalisme capitaliste : N'y a-t-il aucune alternative ? (J. Guazzini, Trad.). Entremonde. (Ouvrage original publié en 2009)
Fleming, D. (2016). Surviving the Future: Culture, Carnival and Capital in the Aftermath of the Market Economy. Chelsea Green Publishing. [Édité par Shaun Chamberlin]
Kingsnorth, P., & Hine, D. (2009). Uncivilisation: The Dark Mountain Manifesto. Dark Mountain Project.
Servigne, P., Stevens, R., & Chapelle, G. (2018). Une autre fin du monde est possible : Vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre). Seuil.
À explorer
Pour approfondir la pensée écosystémique :
- 41‣ Penser l'écologie de nos organisations - Explore en détail l'application des principes permaculturels aux institutions éducatives, notamment l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy et la transformation des hiérarchies en réseaux collaboratifs
Pour concevoir l'intelligence collective comme commun :
- 39‣ Concevoir l'intelligence collective comme commun - Examine comment préserver et développer l'intelligence collective face aux enclosures technologiques, avec des stratégies concrètes de gouvernance participative dans les établissements
Pour explorer les scénarios prospectifs :
- 37‣ Se préparer à la descente - Analyse les paradigmes alternatifs émergents (décroissance, transition) et les scénarios de futurs possibles selon Holmgren, contextualisant la vision «après demain» dans les enjeux systémiques contemporains
Pour cultiver des communautés de pratique :
- 45‣ Cultiver un espace de réflexion et de pratique - Documente l'émergence d'écosystèmes d'échanges entre enseignant·es innovant·es et les conditions nécessaires au développement d'une communauté éducative résiliente